
Avec White, le romancier américain Bret Easton Ellis se fait essayiste et nous livre un regard plus critique que jamais de son temps. Au gré d'évocations de son enfance, de ses amours, de ses rencontres mais aussi de ses ouvrages, l'auteur du best seller American Psycho nous dépeint alors une société victime selon lui d'un « fascisme » moraliste et d'une pensée « victimiste ». Celui qui choqua l'Amérique en 1992 par le récit « désenchanteur » d'un trader, autrefois figure du Self-Made-Man et du Golden Boy « reaganiens » devenu sous sa plume un obscure tueur en série, incarnation de cette autre figure américaine mais cette fois de la mort froide, obsessionnelle et méthodique, nous dépeint dans son nouvel opus un pays miné par la bien-pensance, l'auto-censure et le culte du likable. Un pays où la « liberté d'expression était devenue, semblait-il, un désir de mort esthétisé, un suicide à proprement parler »[1]. Illustrations de cette nouvelle ère du consensus et d'une nouvelle forme de chasse aux sorcières, la diabolisation de Donald Trump et de tous ceux qui ne se positionneraient pas clairement (jusqu'à la caricature) contre lui, et la condamnation sans appel ni nuance de tout propos jugé sexiste ou raciste. Bret Easton Ellis nous dépeint alors une Amérique où règne une dictature du bon sentiment comme du politiquement correct, et où exprimer librement son point de vue ou se livrer à des blagues potaches risque de vous rendre coupable de « crime de pensée »[2].
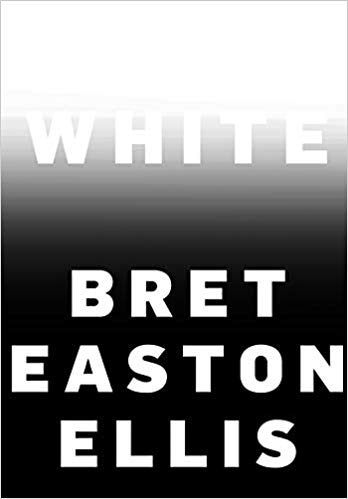
La blancheur évoquée par le titre est donc celle d'un désir de pureté et la volonté d'éradiquer toute obscurité au profit d'une existence immaculée et consensuelle.
Les comparant avec ceux des enfants ayant grandi dans les années soixante-dix, les parents du XXIème siècle poussent alors leur progéniture « dans des espaces sécurisés, et exigent de la positivité tout en essayant apparemment de (la) protéger de tout »[3]. De même les médias américains se voient-ils alourdis d'une mission purificatrice et « inclusiviste » et enferment la culture dans la phobie de l'offense. Cette culture inclusive entend alors protéger chaque individu de toute discrimination, à condition cependant que ce dernier respecte la déontologie labellisée par la twittosphère. Cette positivité néo-libérale que Eva Illouz et Edgar Cabanas avaient déjà interrogé dans leur ouvrage Happycratie en 2018.
Ce précautionnisme, l'auteur le refuse délibérément, préférant ne pas se faire embrigader dans la folie anti-Trumpienne ni dans la survalorisation de films sous le seul prétexte qu'ils ont été réalisés par une femme, s'inscrivant alors à contre-courant d'une intelligentsia hyper moralisée, donneuse de leçons, frileuse et réduite à n'être qu'une police de pensée.
Cette tendance à se draper d'un moralisme accusateur, l'auteur y voit l'expression de ce qu'il qualifie de Post-Empire entrepreneurial. Après les temps grandioses de l'industrie culturelle et du star-system américain (l'Empire) qui seront suivis par une remise en question de ce culte d'une perfection artificielle par des artistes qui au contraire mettront en avant leurs fêlures, privilégiant l'honnêteté et la transparence au glacis de l'image promotionnelle (post-Empire), Bret Easton Ellis entrevoit en ce début de siècle l'établissement d'un « conformisme d'entreprise et de censure »[4] qui a pour effet « l'éradication de la passion et la réduction au silence de l'individu »[5].

Alors tout un chacun devient un commentateur compulsif de cet autre qu'il ne valide et like que si il lui ressemble et confirme sa façon de voir le monde. Mais dans cette culture de la notation sociale et de la surveillance généralisée, l'Autre disparaît. Et si dans le concept de l'ex-sistence, l’altérite pouvait être pour Lacan ce vers qui je me tend pour constituer ma singularité, celle-ci est remplacée par le culte de la conformité bien-pensante. Mais surtout, il y voit la victoire d'une conception dangereusement binaire de l'existence et de la pensée. Dangereuse car elle tend à catégoriser et à polariser l' « être humain » qui se caractérise pourtant par la diversité de ses émotions qui fait de chaque individu un être multiple rempli de contradictions. L'esprit binaire du numérique tend alors à vouloir formater la nature foisonnante et bigarrée de l'homme.
Cette génération Z que Bret Easton Ellis qualifie de « dégonflée » incarne dès lors la disparition de l'humain, avec ses grandeurs mais aussi ses bas-fonds, au profit de l'algorithme et de l'artifice, piliers d'un monde qui ne tolère plus la noirceur. Laquelle fait pourtant partie intégrante de notre humanité. C'est ce que rappelle cet ouvrage à lire assurément.
[1] Bret Easton Ellis, White, Paris, Robert Laffont, 2019, p. 285.
[2] Ibid. , p. 135.
[3] Ibid. , p. 20.
[4] Ibid. , p. 139.
[5] Ibid. , p. 140.